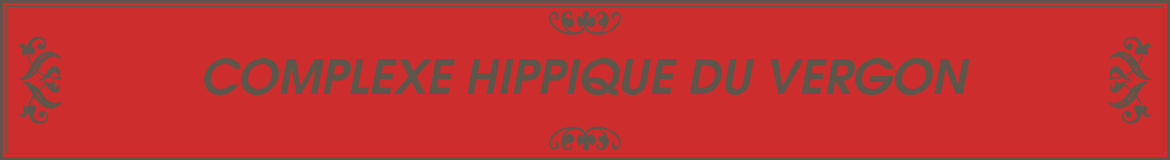L'article publié ici est la Conclusion d'un ouvrage inédit de Bernard Mathié intitulé "PLAIDOYER POUR L'ECUYER".
*
CONCLUSION
LE SUBLIME DANS LA TEMPÊTE
«À certaines époques, les dieux visitent un pays
et quand ils repartent, les hauts temps s’évanouissent…»
Stephan George
et quand ils repartent, les hauts temps s’évanouissent…»
Stephan George
Le 18ème siècle a été le temps fort de l’équitation mondiale ; son théâtre s’est joué sur la prestigieuse scène de Versailles et de son annexe parisienne des Tuileries. Les préparatifs avaient été entrepris de longue date : au siècle d’avant, par les La Broue, Pluvinel, Charnisay, Newcastle ; auparavant encore, par les Grisone, Fiaschi, Pignatelli et bien d’autres ultramontains de la Renaissance.
Au manège de France, les dieux étaient là, illustres à plus d’un égard, certains jusqu’aux confins de l’Europe, se succédant et rivalisant de prestige. Il y avait là les Vernet du Plessis et de La Vallée, les Vendeuil et son élève La Guérinière, les Cazeaux de Nestier, les Salvert, Lubersac et Montfaucon de Rogles, les Neuilly et les d’Abzac, d’autres encore qui avaient moins l’accès aux feux de la rampe et n’en étaient pas, pour autant, moins méritants.
L’Europe entière était sous le charme du tact équestre et du bon goût français. Weyrother à Vienne, Seeger en Allemagne. La Guérinière les avait subjugués, par son art autant que par sa science. C’était le temps où, «dans ce manège, les plus grands soins étaient donnés à la rectitude, à l'élégance de la position, à ce point qu'il suffisait de voir passer un cavalier sortant de cette école pour pouvoir dire : "C'est un élève de Versailles"[1]».
Le sordide couperet de la Révolution et la tuerie des guerres napoléoniennes terrassèrent cette grandeur. Tout comme on avait coupé Chénier en deux, on força le Grand Écuyer à se mésallier en Autriche et l’on trancha la tête au cheval de parade en chantant la carmagnole. Exit Versailles, ses pompes et ses œuvres ! Les dieux étaient dans la tempête, trop anémiés pour résister. Le vent d’Albion la Perfide souffla sur l’équitation française, lui arrachant son âme. D’Aure, qui avait tout appris d’Abzac et si peu retenu, se trouvait en proue du navire en folie. L’enseignement sombra ; avec lui, le savoir-faire ; l’horizon de l’homme de cheval se raccourcit soudain à la seule perspective du champ de bataille. L’art équestre n’était plus d’actualité qu’en filigrane. On avait fait au sublime un enterrement de première classe.
Il fallut l’insolente intrusion d’un Baucher, étranger au sérail, pour réveiller les esprits et donner, dans la fourmilière somnolente des romantiques égarés, le coup de sabot salutaire. Mais le cœur n’y était plus, usé par la rhétorique cartésienne. La technique changea de style ; l’art se ressentit profondément du divorce des forces et du mouvement ; les résistances n’étaient pas que dans le cheval. La sensualité marquait le pas, la mécanique triomphait. Mais, cependant que les dieux préparaient leur retour dans l’arène, ils surent déjà qu’ils y entreraient déguisés en gladiateurs ; et, d’un commun accord, pour ne pas rester dans l’oisiveté démoralisatrice, ils signèrent la charte du parfait «gentleman rider».
D’Aure avait débroussaillé le chemin ; l’Hotte en fit, sans intention maligne, une autoroute aux limites du stade, que vinrent emprunter les champions Wattel, Danloux, Lafont, Jousseaume et autres Lesage, tous brillants mousquetaires de l’olympisme retrouvé, sous l’œil critique de Decarpentry et de Blacque-Belair, les idéologues du club.
Investissant dans le sport tout ce que l’on avait désinvesti de l’art, nous nous retrouvions en tête des nations, prouvant ainsi aux yeux du monde que nous avions de la «ressource».
En coulisses cependant, on continuait le travail de fond, jamais vraiment délaissé, en dépit des invectives d’un Beauchesne. On ne savait plus vraiment où aller ; on cherchait ; on errait de-ci, de-là ; mais bon an, mal an, on conservait à l’équitation un niveau élevé, qui restait enviable au-delà de nos frontières. Face à la montée des dangers d’hybridation, Margot, tout de même, se sentit obligé de rappeler les bases d’une doctrine équestre française et de souligner tout particulièrement que la légèreté de nos chevaux valait bien la précision forcée des autres et que la liberté retrouvée chez les nôtres était somme toute préférable aux enrênements coercitifs des autres.
Les «gentlemen riders» cependant semblaient sourds à ce coup de semonce. Les sirènes germaniques redoublaient de séduction et, prenant juges, cavaliers et chevaux dans la nasse de toutes les dérives, encapuchonnaient littéralement les meilleures volontés, les tiraient vers le bas, en rondeur simulée, et éteignaient la liberté au nom du score. Aux plus hauts sommets, la théorie de l’échec contrecarrait celle de «l’athlète heureux» ; le «massacre des innocents» était décrété.
Déjà, la tradition d’une équitation à la française s’était délocalisée ; et, non sans logique, c’est du Portugal qu’était venue la nouvelle donne, à travers la géniale synthèse entre les anciens et les modernes qu’avait réussie Oliveira, «cet apôtre de l’équitation française», en raccrochant les wagons de Baucher à la locomotive de La Guérinière. Nous aurions pu repartir sur des rails tout neufs vers la prochaine gare. Toutefois, les aiguillages étaient faussés. La science, soudain, se trouvait en désaccord avec la technique. Il faut du temps au temps pour rééquilibrer la balance ; au pays de l’équitation, bien plus qu’ailleurs.
Mais, paradoxalement, c’est dans les périodes de crise que le génie du bien souffle dans les cœurs et les esprits. Quand on n’a plus grand-chose à perdre, on a tout à gagner d’une profonde remise en question. Le tout, c’est d’avoir l’audace d’y procéder.
Le monolithisme militaire de l’équitation française a, depuis quelques décennies, du plomb dans l’aile. Nos écuyers n’y sont strictement pour rien, eux qui ont été ballottés, de génération en génération, entre les options velléitaires des politiques et les impératifs contradictoires de l’instruction de la troupe. Que l’équitation de campagne ait (assez naturellement) débouché sur l’équitation sportive n’est pas le symptôme le plus marquant du déviationnisme. Du jeu de la bague à ceux du stade, il n’y a qu’une différence de style. Il faut chercher ailleurs la cause d’un abandon progressif des vrais principes de l’art équestre.
Si le 19ème siècle est celui de l’explosion économique et industrielle, annonciatrice d’une mécanisation des tâches humaines, le 20ème passe pour celui de la libéralisation des servilités du travail, précisément par le relais des machines, et de la conquête des loisirs. La principale résultante de cette évolution est une pression démographique à l’entrée de la formation équestre, ce que d’aucuns appellent la «démocratisation de l’équitation». Le phénomène sociologique n’a rien de condamnable en soi, bien au contraire. Il se trouve pourtant à l’origine de deux facteurs importants de perturbation, tous deux frappés du mauvais sort : d’une part, la masse des cavaliers amateurs est remontée en chevaux de mauvais aloi ; d’autre part, la multiplication des centres de formation s’est faite au détriment de la qualité de l’instruction.
La vérité en face, c’est qu’il n’y a plus guère qu’au plus haut niveau de la pyramide que la conservation des principes de base de l’art équestre pourrait être assurée ; mais les gardiens du temple sont fatigués, voués à travailler dans l’ascétisme et le dénuement ; personne, ni au sommet de l’État, ni à la tête de la Fédération sportive délégataire du service public, ne se préoccupe réellement de leur devenir ; aussi les défections se multiplient-elles sans que la relève brille par l’expérience ou par sa science.
La vérité en face, c’est aussi le fait que, tout comme la compétition, l’art équestre est, par nature, élitiste ; n’en déplaise aux chantres de l’égalitarisme ! Les meilleurs seuls sont pris en compte. Le «bidouillage» des autres peut certes constituer une «thérapie du loisir », mais ne fait en rien progresser l’art et n’améliore pas le score. C’est cela la réalité ; qu’elle soit triste ou joyeuse n’apporte rien au constat.
Les conditions économiques de l’exploitation des entreprises de manège — je parle de celles qui s’entêtent à vouloir faire pratiquer une équitation de qualité — sont à ce point précaires que l’hécatombe des structures se profile immanquablement dès que la menace d’un resserrement du système de subventionnement public est dans l’air. Or, à bien analyser, c’est la médiocrité seule qui se trouve encouragée.
L’écuyer reste debout, contre vents et marées, droit sans ses bottes. Faut-il qu’il tienne le cheval en haute estime pour lui sacrifier tant de choses de la vie auxquelles il pourrait, comme tout un chacun, légitimement prétendre ? Son secret est d’avoir compris, au contact intime des chevaux, que c’est très précisément lorsque pour soi-même l’on n’attend rien de l’amour, mais qu’on espère tout pour l’autre, qu’on a renoncé à courir après le retour d’investissement, qu’il est là, cet amour à l’état pur, féérique et magique, envahissant et débordant.
Essayez donc d’expliquer cela à un technocrate ! Il a pourtant, tout comme le cheval, un cerveau. Le même, à la pensée logique près ; quoique…
Alors, ce n’est plus le regret de la splendeur passée qui compte ; seule, la menace de l’orage qui s’amoncèle devrait nous interpeller, tous, sans exception. Les hommes en seront les victimes à un degré bien moindre que le cheval.
Fin. 26 mai 2009.
[1] Alexis L’Hotte in Un officier de cavalerie. Ce souvenir reste vivace en Allemagne, où un Egon von Neindorff peut, juste avant sa mort survenue en 2004, écrire, sans susciter la moquerie, que «la position du cavalier est la clé qui détermine l’efficience de toutes les autres aides».